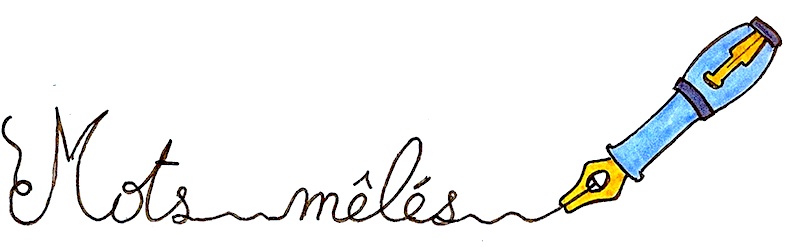C’était trop stupide.
Il allait mourir, là, à quelques centaines de mètres de la ferme des Bailly-Benoit.
Enseveli sous la neige.
Victime de ce qu’on nommerait son imprudence, son inconscience.
Victime de ce sens du devoir qui faisait qu’il ne pouvait pas laisser un malade abandonné.
Ils étaient venus le chercher peu avant le coucher du soleil, les deux fils du paysan. La tempête commençait seulement mais menaçait de s’aggraver. Il leur avait interdit de retourner à la ferme avec lui.
Les deux jeunes gens, à peine sortis de l’enfance, étaient épuisés par leur marche dans la neige. Ils n’auraient pas la force de faire le chemin inverse.
Ils passeraient la nuit chez lui. Il avait averti Suzanne qu’elle leur préparât un repas et un lit. Demain, on aviserait.
Et il était parti dans le soir qui tombait. Il connaissait bien le chemin de la ferme du Rotsa, mais le vent était si fort qu’il lui fut vite impossible de se repérer. Et son cheval enfonçait de plus en plus dans la neige fine et soufflée qui s’amoncelait en hautes concières. (Congères)
Il avait renvoyé l’animal, qui, grâce à son instinct, retrouverait la maison, à condition que la tempête ne bloquât pas complètement le passage. Lui, au moins, avait toutes les chances de s’en sortir.
Il essaya de continuer à pied. Chaque pas était une souffrance. Et le vent piquait ses yeux, la neige glaçait son visage, la nuit engloutissait la forêt.
Il parcourut encore une partie du chemin, avant de s’avouer vaincu. Il croyait être arrivé au carrefour des Mouguettes. Il avait cru apercevoir la forme du chasal (ruine) sur sa droite. Mais, avec cette neige, les repères habituels étaient brouillés.
Il devait rebrousser chemin : il fallait se rendre à l’évidence, il n’atteindrait jamais la ferme où le père des enfants venus le prévenir gisait sur son lit, la poitrine écrasée, la veille, par une branche du foyard qu’il coupait.
Sans soins, le fermier allait mourir, mais lui-même était en danger.
Sacrifier sa propre vie pour tenter follement de se rendre au chevet d’un homme qui avait peu de chance de survivre était absurde.
Il songea amusé à ce qu’on lirait, en latin, dans le registre paroissial : mort à cause des intempéries, noyé dans la neige, in nive soffocatus, sans avoir reçu les secours de l’église. Un athée comme lui !
Il s’épuisait à marcher dans la neige. Alors il se retourna, décidé à revenir vers le village. La marque de ses pas avait disparu, effacée en un instant par la tempête. Il se remit en route, se traînant sur les coudes et les genoux, fit quelques dizaines de mètres, puis tomba dans un trou. Il pesta, essaya de se relever. En vain.
Il n’avait plus de force.
Il eut un éclat de rire. La tempête avait gagné.
Il sentait moins le froid. Il était un peu abrité du vent.
Il se laissa aller sur le dos. Les flocons, fin duvet blanc, recouvraient son visage. C’était comme si on avait plumé un canard au-dessus de lui !
Il se souvint d’épiques batailles de polochon avec ses camarades lorsqu’il était en pension à Saint-Oyend. Et des punitions immanquables qui suivaient, et des frères quatre bras qui menaçaient de tout rapporter à leurs parents mais s’en gardaient bien, craignant que ces derniers, bons chrétiens et bons payeurs, ne leur retirassent leur progéniture.
Dire qu’il aurait pu, comme la plupart de ses amis de l’époque, installer son cabinet en ville et mener une existence aisée et agréable ! Invité aux bals que donnait le sous-préfet, fréquentant les notables locaux, courtisé par les meilleurs partis de la petite cité. Un notable parmi les notables ! Mais il avait choisi de revenir dans son village de montagne, à soigner des paysans impécunieux ou avares, qui appelaient le médecin en même temps que le curé, lorsqu’ils étaient à l’article de la mort.
Il sentait l’engourdissement le gagner. Il ferma les yeux. Il savait que la mort était là, dans ce sommeil si tentant et si doux. Il se revit, petit enfant, dans son lit, tandis que sa mère soufflait la bougie et lui donnait un baiser sur le front.
Ses petits avaient faim. Elle avait essayé de les nourrir, mais elle n’avait presque plus de lait. Elle aussi, la faim la torturait, depuis plusieurs jours qu’elle n’avait pu chercher de la nourriture. Il fallait qu’elle sortît. Elle entendait la tempête qui se déchaînait dans les sapins, mais elle ne pouvait plus rester dans la tiédeur de la tanière, sinon ils allaient mourir.
Elle passa le bout de son museau hors du trou. Le vent était fort, il neigeait abondamment. Elle pensa qu’il serait plus difficile de se déplacer, mais que les proies seraient moins mobiles. Elle avait bonne chance d’attraper quelques rongeurs imprudents.
Elle s’avança sous les grands arbres qui gémissaient. Elle passa devant les pierres carrées couvertes de neige. Jadis il y avait eu une maison à cet endroit.
Elle fit encore quelques pas, reniflant attentivement l’air chargé de flocons.
Elle s’arrêta, effrayée. Se tapit le plus profondément qu’elle le pouvait.
L’odeur de l’ennemi. L’odeur de leur plus cruel ennemi. Le barbare qui les tuait, les dépeçait, arrachait leur peau et leur fourrure. Capable d’accrocher au cou de sa victime un objet qui sonnait à chaque mouvement du malheureux, pour lui rendre la vie impossible, pour l’affamer progressivement, le supplicier jusqu’à ce qu’une mort atroce l’emporte enfin.*
L’odeur venait d’un petit monticule de neige situé à quelques dizaines de mètres.
Ce n’était pas l’odeur d’un cadavre. C’était l’odeur d’un homme vivant. Caché sous la neige pour la capturer ? Il fallait rester prudente, ils avaient toute sorte de pièges, des lames qui coupaient les pattes, déchiquetaient les corps, broyaient les os. Mais l’homme, sous la neige, paraissait immobile.
Inoffensif ?
Mourant ?
Elle devrait patienter et attendre que l’homme fût mort, pour en enlever des morceaux de chair, s’en nourrir pour pouvoir ensuite nourrir ses petits.
Elle n’avait jamais mangé de la viande d’homme.
Elle resta longtemps immobile sous la neige qui tombait.
L’homme gémissait de plus en plus faiblement.
Autour d’elle, elle commença à sentir un peu de mouvement. Elle n’était pas la seule à avoir repéré le futur cadavre. Il ne fallait plus attendre. La concurrence serait rude et elle ne pouvait se permettre de passer après les animaux plus forts qu’elle qui ne lui laisseraient que des bribes de sa proie.
Elle s’approcha, commença à creuser la neige jusqu’à atteindre le corps. Elle vit le visage aux yeux fermés. Elle renifla.
Elle reconnut l’homme.
Il passait souvent dans la forêt ou sur les chemins, portant avec lui une sorte de lourd sac, qui sentait la peau d’animal et allait chez les humains malades. Elle l’avait compris une fois qu’elle avait été surprise en train de voler des poules chez un paysan. Le fermier voulait prendre son fusil mais l’homme au sac en peau l’avait arrêté. Elle n’avait pas compris ce qu’il avait dit, mais elle savait que l’homme avait dissuadé le paysan de tirer.
Elle se mit à lui lécher les yeux, puis le visage. Longuement. Méthodiquement.
Elle avait oublié sa faim, celle de ses petits. Elle voulait sauver cet homme.
Elle ne savait pas bien pourquoi, mais elle ne voulait pas qu’il mourût.
C’était stupide, il n’était sans doute pas meilleur que les autres, mais elle éprouvait cela comme une nécessité. Son instinct de mère n’acceptait pas la mort de cet homme.
La tempête s’était calmée. On arrivait même à apercevoir quelques étoiles.
Il faisait nuit noire.
Le maintenir en vie, empêcher qu’il ne s’abandonne au sommeil mortel.
Elle s’était couchée sur lui à présent, tentant de le réchauffer avec son corps, avec la douce et épaisse fourrure qui la recouvrait.
L’homme était toujours vivant. L’aube approchait.
Elle entendit des bruits, des voix, des hommes qui criaient, elle aperçut des lumières dans le fond du bois qui venaient dans sa direction.
Elle se leva, secoua la neige qui la recouvrait, et s’éloigna.
Elle devait encore trouver à manger pour ses petits.
- Voir de Goupil à Margot, de Louis Pergaud
Retour à la page des thèmes