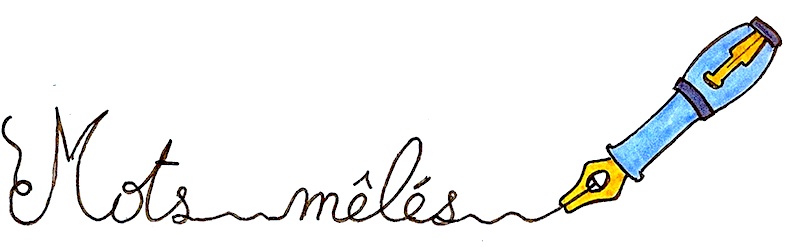Quand ils se réveillèrent le matin du dimanche vingt-trois juillet, les habitants de la petite ville de K découvrirent un étrange phénomène. Un immense disque brillant et apparemment immobile surplombait la cité. Il était difficile d’estimer quelle était son altitude mais il ne semblait pas voler très haut car sa masse imposante bloquait les rayons du soleil matinal.
Comment était-il arrivé et quand, on ne put le savoir, car même en analysant méthodiquement les enregistrements des caméras de surveillance placées dans tous les quartiers de la ville, en scrutant attentivement tous les rapports émis par les installations radars militaires ou civiles du pays, on ne le voyait pas approcher ni se mettre en place dans le ciel de K, comme s’il était né spontanément de quelque région inconnue de l’univers.
Le disque mesurait plusieurs kilomètres de diamètre, comme on put s’en rendre compte en envoyant des hélicoptères à proximité. Mais il fut impossible aux pilotes de s’en approcher autant qu’ils le souhaitaient, car une sorte de vent magnétique extrêmement puissant repoussait les machines, si bien que les pilotes durent s’éloigner au risque de mettre leur vie en péril. Les chasseurs de la base aérienne de Muns connurent le même problème. En outre les appareils de bord des avions se déréglaient en approchant de l’objet : les pilotes perdaient tout sens de l’orientation et furent contraints de rejoindre leur aéroport en hâte. On essaya les drones, le constat fut le même, on ne pouvait approcher du disque.
On se rendit compte aussi très vite que l’objet volant recouvrait exactement la superficie de la cité, du centre aux plus lointains faubourgs, à l’exception de la grande zone commerciale de Brix demeurée à l’extérieur. Le milieu du disque était placé juste au-dessus de la cathédrale Saint Pierre. Certains y virent un signe divin. Pour eux, le phénomène céleste était un châtiment envoyé par un dieu trop souvent négligé. Ils se regroupèrent en une secte informelle dont les membres parcouraient les rues de la ville en se fustigeant et en frappant sur des couvercles de casseroles tout en exhortant les habitants au repentir dans les plus brefs délais : pour les aider dans leur acte de contrition, ils leur proposaient des séances de confession collective en plein air, évidemment payantes.
Cependant l’objet ne semblait pas particulièrement menaçant. Des observations scientifiques approfondies permirent de déterminer qu’il ne dégageait aucune radioactivité ni n’émettait aucun élément chimique qui pût causer des dommages à la santé des habitants.
En l’observant mieux on constata que le disque tournait très lentement sur lui-même, à partir d’un axe situé en son centre, que son altitude et sa rapidité augmentaient au fur et à mesure que le jour avançait. Il se trouvait à hauteur et vitesse maximales à midi précis pour redescendre et ralentir ensuite. La giration faisait entendre un très léger ronronnement qui devint vite habituel et rassurant pour les citoyens de K.
Autre phénomène étrange, lié sans doute à ce magnétisme qui rendait les avions et les hélicoptères inopérants, les habitants qui, le premier jour, pris de panique, tentèrent de quitter la ville en auto, virent leurs véhicules s’arrêter net dès qu’ils furent arrivés aux limites de l’ombre portée par le disque. Les moteurs tournaient, mais les véhicules étaient bloqués, causant un bel embouteillage. Cette paralysie des autos provoqua, on s’en doute, des réactions de peur incontrôlées et amena à des interrogations bien compréhensibles. Il en fut de même pour les trains qui ne pouvaient dépasser la frontière marquée par l’objet volant. Les piétons qui tentaient leur chance se sentaient comme soulevés par un tourbillon pour être ensuite déposés quelques mètres en arrière, sans que cela ne provoquât la moindre blessure.
Certains essayèrent de passer à cheval, en calèche, sans plus de succès. Les bêtes de selle ou de trait pouvaient franchir la frontière mais les cavaliers ou les cochers étaient repoussés systématiquement vers leur point de départ. Quelques rares resquilleurs qui voulurent se frayer un chemin par les égouts furent eux aussi ramenés à la surface par un vent puissant qui s’engouffrait dans les galeries. Il en alla de même pour ceux qui, empruntant la rivière Melna, essayèrent de franchir la frontière en canoé.
Le disque interdisait de sortir de la ville de K.
Malgré cela, une fois dissipées les premières craintes, les habitants ne sentaient pas la présence de l’objet volant comme hostile ou dangereuse.
Les photos qu’on parvint à prendre depuis les satellites ou des avions volant très haut montraient que la partie supérieure du disque tournait dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, tandis que le sens de giration de la partie inférieure était inverse. Il y avait donc en réalité deux disques superposés dont l’un, l’élément supérieur, était formé de petits triangles lumineux, renvoyant comme un kaléidoscope la lumière du soleil en milliers d’éclats de toutes les couleurs, invisibles depuis la ville de K, et l’autre, beaucoup plus simple, présentait seulement un bel aspect métallique et poli.
Voyant une photo prise de loin qui montrait le flanc de l’objet, une fillette fit remarquer que le disque ressemblait à s’y méprendre à l’une de ces toupies mécaniques d’autrefois, semblable à celle avec laquelle elle jouait chez sa grand-mère. Et les habitants de la ville, avec une pointe d’affection teintée parfois de moquerie, prirent l’habitude d’appeler « toupie » le mystérieux objet volant.
Pendant quelque temps le disque de K fut l’objet de toutes les émissions de télévision. Cependant, et certains en firent l’amère expérience, une fois qu’on était entré sous l’ombre du disque on ne pouvait plus en ressortir, aussi les équipes de télévision préférèrent-elles rester à l’extérieur. Les journalistes devaient se contenter d’images lointaines. Leurs commentaires semblaient un peu ridicules : même si l’on voyait derrière eux la forme du disque se détacher dans l’azur du ciel, on manquait de la présence réelle des journalistes au plus près de l’événement. L’impact médiatique du phénomène en fut très diminué. Les réseaux sociaux prirent le relais. Les habitants envoyaient sur les sites spécialisés les vidéos qu’ils faisaient eux-mêmes et commentaient en direct la situation qu’ils vivaient. Des vocations de journalistes et de cinéastes naquirent à cette occasion.
Dans tout le pays se déroulaient d’innombrables forums d’experts, on assistait à de sévères controverses entre savants, à tel point que le professeur Bidon, président de la faculté des Sciences de Lutèce, provoqua en duel le docteur Druidoult qui s’opposait virulemment à son hypothèse. On proposa une multitude d’explications. Pour certains il s’agissait évidemment d’un vaisseau spatial d’origine extraterrestre, ce à quoi d’autres répliquaient que son allure de toupie mécanique vintage avait quelque chose de bien terrien. On rétorquait à ces derniers que les extra-terrestres n’étaient peut-être pas au courant des dernières tendances en matière de toupies. Quelques psychanalystes suggérèrent qu’il pouvait s’agir d’une hallucination collective, une image mentale, née d’un traumatisme ancien, remontant peut-être à la seconde guerre mondiale quand la ville avait été sérieusement bombardée, une simple image-souvenir que la puissance de l’autosuggestion avait rendue matérielle, hypothèse que la réalité physique de l’objet volant rendait aisément caduque. Les religieux y voyaient une occasion de louer la grandeur de dieu, les gauchistes une invention du capitalisme libéral destinée à opprimer un peuple toujours plus soumis. Les collapsologues se réjouissaient répétant sans cesse : « Nous vous l’avions bien dit », les fake news abondaient, les complotistes se déchaînaient, on accusait la globalisation, la mondialisation, la déforestation, les Chinois, les gays, les musulmans, les végans, les chasseurs, les anti-chasseurs, les politiciens, les juifs, les noirs...
Mais la majorité du peuple se moquait de connaître l’origine de « la toupie » et s’accommodait fort bien de la présence du disque au-dessus de la ville.
Certains profitaient de la situation pour ouvrir des établissements au nom astucieux comme l’Ovni you, une boîte de nuit qui rencontra immédiatement un grand succès. La série télé « Ufo Ufopa » remplaça aisément « fais pas ci fais pas ça ».
Étonnamment les politiciens du pays se montrèrent d’une grande discrétion et ne parlèrent pas à tort et à travers d’un phénomène qu’ils ne comprenaient pas plus que le reste de la population. On ne vit pas la gauche et la droite s’invectiver stérilement. Seul le parti national populaire, le natpop comme on l’appelait couramment, hurlait à tout va qu’il fallait fermer les frontières pour éviter une invasion d’Aliens et renvoyer dans leurs planètes tous les individus suspects. Les ufologues du parti avaient même dressé un portrait-robot de l’ennemi à partir de la photo de l’être mystérieux trouvé à Roswell, mais comme le dessin obtenu ressemblait à s’y méprendre au portrait de la présidente du natpop on oublia aussitôt ce projet.
Les extraterrestres étant revenus à la mode, on ressortit une veille série télé américaine racontant les aventures d’un certain David Vincent, ce qui eut une conséquence inattendue : les gens observaient attentivement l’auriculaire de leur interlocuteur avant de lui serrer la main, cause parfois de situations embarrassantes.
Le président d’un grand pays, toujours partisan de solutions radicales, proposa de lancer une bombe atomique sur le disque pour le détruire, « On allait quand même pas se laisser envahir par des f... Aliens ! » La population de la ville serait anéantie, mais comme il le répétait, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. Heureusement sa proposition extrême fut repoussée au dernier moment, à la grande déception dudit président se plaignant de la mollesse des dirigeants de pays qui n’avaient pas la chance de connaître le deuxième amendement.
Puis, peu à peu, l’enthousiasme et la curiosité manifestés par les télés du monde entier retombèrent. Le disque était ennuyeux, sans surprise, lointain, à côté de certains phénomènes autrement plus attirants. D’autres sujets détournèrent l’attention des médias : un remaniement ministériel, un terrible tremblement de terre au Moujikistan, une élection présidentielle, un scandale provoqué par une liaison entre un ministre britannique et miss Liechtenstein, le grand prix de l’Eurovision gagné par une trans d’origine zimbabwéenne, ou encore une naissance royale. Et on oublia le disque de la petite ville de K.
Quant aux habitants de K, ils avaient à présent pris l’habitude de vivre avec cette masse métallique au-dessus de la tête. Et même, chaque matin, les citoyens, avec une petite pointe d’angoisse au cœur, se levaient et en ouvrant leurs volets s’assuraient que l’objet volant était toujours présent dans le ciel. Ils auraient ressenti l’absence du disque comme une sorte d’abandon ou de désertion. La « toupie » leur appartenait, elle était un élément qui donnait une valeur particulière à des existences le plus souvent banales et, à leur cité, une reconnaissance internationale, quoiqu’amoindrie désormais.
On affirmait d’ailleurs que le disque ne constituait en aucun cas une menace, mais au contraire protégeait la population des radiations solaires dangereuses. Pour pallier le manque de lumière, on avait multiplié les cabines de bronzage, et, substitut de la mer aux plages inaccessibles, le petit lac urbain de Mark était pris d’assaut en permanence. Il régnait un petit air de vacance, comme si la présence de ce couvercle tournant rendait l’air plus léger, la population plus insouciante. On se sentait à l’abri sous cette couverture circulaire, enfermé, contraint, mais plus libre d’une certaine manière. On découvrait une nouvelle façon de se comporter avec les autres et la plupart des gens ne vivaient pas cette sorte d’enfermement comme une épreuve douloureuse.
Et puis, même si on ne voyait pas directement le soleil, il ne pleuvait jamais, ce qui à tout prendre n’était pas désagréable. Pour éviter la sécheresse, en périphérie de la ville on recueillait l’eau de pluie qui tombait des bords du disque dans de grands bassins disposés tout autour de la cité. L’eau ainsi récupérée était distribuée gratuitement et on avait multiplié les fontaines dans la ville. Comme les enfants trouvaient triste que la neige ne fût pas présente à Noël, la municipalité, consciente de ce problème, fit venir des chasse-neige qui transportèrent de façon égale dans tous les quartiers la couche blanche recueillie aux frontières de la cité.
Pour les échanges économiques et commerciaux avec l’extérieur on avait recours au troc. Les productions des habitants et des entreprises de K étaient déposées à la limite de l’ombre portée du disque où elles étaient récupérées par des employés extérieurs qui les chargeaient dans des camions ou des trains garés au-delà de la zone interdite. On pratiquait de même dans l’autre sens. On avait en effet remarqué que les marchandises et les animaux n’étaient pas soumis à cette interdiction de franchissement des limites fixées par l’ombre.
Ces échanges étaient longs et coûteux, et, peu à peu les habitants modifièrent leurs habitudes et se mirent à consommer en priorité les fruits et légumes cultivés sur place dans des serres chauffées. Enfin, ne pouvant se rendre dans les grandes surfaces périphériques, ils retournèrent dans les commerces situés à proximité. Les citoyens enfermés retrouvaient une forme de solidarité qu’ils avaient oubliée depuis longtemps, une vie sociale plus riche et profonde. Comme les automobiles étaient devenues presque inutiles, on se déplaçait à pied ou à vélo. Les talents individuels étaient mis au service de la collectivité, les initiatives sociales se multipliaient. Les citoyens se découvrirent des passions pour la pâtisserie, le macramé, les puzzles, les jeux de société, les arts martiaux, la lecture, l’écriture, la peinture ou la pratique de la méditation.
La vie s’écoulait paisible dans ce confinement accepté de bon gré par la majorité des habitants. Ce qu’ils appréciaient le plus était le silence qui régnait dans la petite ville. Plus d’avions, plus de motards enragés traversant les rues endormies à trois heures du matin en faisant hurler leurs grosses cylindrées ou de mobylettes obstinées dérangeant par leur vacarme strident les malheureux citoyens. On entendait à nouveau le chant des oiseaux et chacun s’en réjouissait. Les oiseaux d’ailleurs, décontenancés au début, avaient vite compris le parti qu’ils pouvaient tirer du disque. Ils faisaient leurs nids dans les alvéoles disposées sur les flancs de l’objet volant, bien protégés ainsi des prédateurs mais aussi du mauvais temps. Il leur avait fallu s’habituer à avoir des nids tournants, mais ils avaient vite su s’adapter à ces nouvelles conditions.
Et puis un jour, on aperçut une échelle de corde qui se déroulait à partir de l’axe fixe du disque et dont l’extrémité se trouvait au bord de la flèche la plus haute de la cathédrale.
Le cœur battant, les citoyens en alarme s’attendaient à chaque instant à voir descendre un extraterrestre du centre de l’objet volant, mais rien ne se passa de la journée. Ni le lendemain, ni les jours suivants. L’échelle tendue entre la toupie et la cathédrale suivait les mouvements du disque, s’allongeant du matin jusqu’à midi, puis se rétrécissant ensuite.
Était-ce une menace d’invasion, un avertissement, un message, une invitation, qu’on leur envoyait ? Fallait-il qu’un courageux et intrépide volontaire gravît les marches pour pénétrer à l’intérieur de la toupie ?
Ou au contraire, cette échelle signifiait-elle un attachement définitif de l’objet volant à la cité qui ne l’avait pas rejeté mais accueilli sans hésiter ? Quelques voix légèrement discordantes rappelaient cependant que les habitants avaient adopté le disque parce qu’ils n’avaient pas eu vraiment le choix de faire autrement.
La plus grande perplexité régnait. L’événement suscita un léger regain d’intérêt des médias pour le phénomène du disque volant de K. On guetta avec impatience pendant quelques jours la descente d’un Alien, mais comme il ne se passait rien et que les commentateurs, toujours exilés aux marges de la ville, étaient à bout de leurs ressources pour meubler le vide, les équipes de télévision disparurent du jour au lendemain.
Les médias avaient peut-être eu tort. En effet, quelques jours plus tard, un petit garçon raconta à ses parents l’étrange aventure qui lui était arrivée durant la nuit. Il s’était retrouvé au pied de l’échelle de corde, sans savoir comment et il l’avait escaladée sans peine. Arrivé en haut, il avait pénétré dans une demeure extraordinaire, dont la pièce la plus stupéfiante était une immense salle de jeu : des milliers de jouets étaient à la disposition des enfants qui se trouvaient là en grand nombre occupés à s’amuser : toutes les boîtes de Lego, même les plus rares, tous les Play Mobil imaginables, les meccanos, les Kapla, ainsi que des jeux vidéo, des trains électriques, des jeux de société et de cartes à l’infini, sans oublier peluches, poupées, ballons, trottinettes, bicyclettes, de quoi contenter le plus insatiable des enfants. Mais personne ne parlait, garçons et filles jouaient en silence, sans un mot, sans un cri, sans un rire, ce qui était quand même un peu triste. Puis sans savoir comment il était rentré, le garçon s’était retrouvé dans son lit. Les parents se hâtèrent de communiquer l’aventure de leur fils aux médias locaux qui en firent leur sujet principal pendant quelques jours.
Il y eut ensuite le témoignage de la cheffe d’un grand restaurant qui raconta comment elle s’était retrouvée, après avoir escaladé l’échelle de corde, dans une magnifique cuisine, entièrement équipée, dotée d’ingrédients d’une qualité exceptionnelle. Elle avait été secondée par une brigade d’auxiliaires affairés mais muets, et avait enfin réussi une recette qu’elle avait échoué des dizaines de fois à réaliser dans son établissement, un plat d’une complexité incroyable, que Brillant-Souverain lui-même avait défini comme irréalisable sur terre, le fameux Garamond à la Ludowienne. Le mets était d’une subtilité et d’une finesse incroyables, mais quand elle était redescendue sur terre, à sa grande déception, elle avait oublié le goût et la composition du plat merveilleux.
Un coureur de jupons notoire, dont les mariages excentriques et les divorces tapageurs défrayaient régulièrement la chronique people, déclara qu’à l’entrée du disque il avait franchi un sas en forme de sexe féminin et qu’il avait été accueilli en haut d’un somptueux escalier par une magnifique jeune femme aux belles épaules nues, enveloppée dans une longue robe blanche décolletée. Un parfum suave accompagnait les mouvements de la jeune femme qui l’avait invité de la main à se rendre dans une chambre elle aussi toute blanche, éclairée de bougies de cire. Des bouquets de fleurs blanches embaumaient toute la pièce. Sans prononcer un mot, elle l’avait attiré sur le lit et avait déposé sur ses lèvres de longs baisers d’une douceur qu’il n’avait jamais connue. Ils avaient fait l’amour sans jamais se lasser. Puis ils s’étaient endormis dans les bras l’un de l’autre. Quand il s’était réveillé il était dans son propre lit, seul, et ne pouvait se souvenir des traits de son amante merveilleuse.
Un écrivain en panne d’inspiration avait trouvé dans le cœur du disque une vaste salle, très haute, où planaient des sortes de bulles transparentes contenant des idées de récit plus brillantes les unes que les autres. Il suffisait de les cueillir au vol pour qu’elles devinssent l’objet d’une nouvelle ou d’un roman à succès. Il avait pris des notes en hâte sur son calepin et se promettait de travailler sans relâche à l’écriture de ce qui serait son œuvre majeure. Quand il était revenu sur terre, hélas, son carnet avait disparu et sa mémoire lui faisait défaut.
Une ménagère de moins de cinquante ans, adepte du rangement et qui ne supportait pas le moindre désordre ni la moindre poussière dans sa maison, trouva dans la toupie une sorte de magasin immense et parfaitement silencieux, où on proposait toutes les solutions possibles pour que les choses soient toujours à leur place et des robots aspirateurs tout à fait stupéfiants. « Mieux que chez Ikrea et Leprince-Potter réunis» avait-elle dit au journaliste de la radio locale qui l’interviewait, mais elle aussi avait tout oublié des judicieux agencements proposés quand elle avait regagné son domicile.
Un bibliophile raconta qu’il avait vu dans l’objet volant la plus grande exposition de livres au monde : et parmi les millions d’ouvrages présentés, tous d’une valeur indicible, il avait découvert l’inestimable manuscrit des Mille et deux matins de Khorasam, en langue persiquienne, incunable unique du IXème siècle qu’on croyait perdu dans l’incendie de la bibliothèque d’Ispagrahn en 1324. Il l’avait touché, avait effleuré sa couverture en peau de chameau de Bactriane, suivi de son doigt le texte mythique, pleuré en déchiffrant les lettres. Et quand il s’était retrouvé chez lui, il ne se souvenait plus de l’odeur du vieux manuscrit ni du texte qu’il avait eu le loisir de lire en entier dans le ventre du disque volant.
Une star de cinéma, acteur mondialement célèbre, qui s’était trouvé bloqué à K alors qu’il devait recevoir un prix honorant sa longue carrière, après avoir, lui aussi, gravi l’échelle de corde et franchi la porte d’un studio où était écrit en lettres d’or MacKinley Pictures, s’était retrouvé comme personnage principal sur le tournage du plus grand blockbuster jamais réalisé, dirigé par Mark Stollenberg lui-même. Dans la scène centrale du film de science-fiction, Planète brisée, il devait tomber dans le vide sidéral après avoir triomphé du pire ennemi de la galaxie. L’acteur racontait qu’au terme de sa chute interstellaire il s’était réveillé dans sa chambre d’hôtel, sans aucun souvenir de sa traversée de l’univers.
Il serait fastidieux de faire la liste de tous les habitants de K qui, après avoir monté à l’échelle de corde, avaient vécu des aventures prodigieuses : une pianiste virtuose avait joué toutes les sonates de Mozart sans jamais sauter une note, un grand joueur de football avait quant à lui marqué le but victorieux de la finale de la coupe du monde, un simple médecin de ville avait découvert un vaccin contre le Pirovirus 20... Un numismate avait eu dans les mains le fameux Thaler du roi Heribert de Hohenwald, dit le magnifique, un collectionneur de timbres avait admiré le 10 cents de 1791 dessiné par George Washington lui-même. Une jeune fille avait assisté à la remise de son diplôme de fin d’études de la plus prestigieuse des universités... Des citoyens de toutes les conditions sociales, de tous les âges, avaient eu le bonheur de voir réalisés leurs désirs les plus chers, mais tous n’avaient plus, à leur retour sur terre, qu’un souvenir vague, une impression brumeuse de ces moments extraordinaires. Il leur restait surtout au fond d’eux-mêmes le sentiment étrange que le silence le plus absolu régnait dans chacune des situations vécues.
On ne sera pas étonné d’apprendre que les caméras braquées en permanence sur le disque et en particulier sur l’échelle de corde n’enregistrèrent aucun de ces mouvements de montée ou de descente.
Et pendant des mois il ne se passa rien de particulier. Le disque tournait toujours dans le ciel de K, attaché à cette échelle comme à un cordon vital, projetant son ombre aux limites de la ville que personne n’avait plus jamais essayé de franchir.
L’absence d’éclairage direct du soleil était un peu difficile à supporter, c’était comme vivre dans ces villages de montagne situés dans des vallées profondes où les rayons de l’astre lumineux ne parviennent pas l’hiver. Mais les avantages de l’ombre, le sentiment de protection que donnait le disque, la paix, la douceur de vivre dans cette cité devenue si humaine, l’emportaient sur les inconvénients.
Les citoyens étaient heureux, sans souci, rassemblés en-dessous de leur « toupie ».
Jusqu’à ce qu’un jour un petit garçon qui jouait au bord de l’ombre du disque lançât son ballon rouge contre la limite interdite. Cet amusement, sorte de Jokari sans élastique, pratiqué par tous les enfants de la ville dans les premiers temps, était tombé en désuétude par la suite, les parents voyant d’un mauvais œil leurs petits s’aventurer au bord de la limite d’ombre. Ce jour-là donc, le garçonnet s’était rendu en cachette au bord de la zone interdite avec un groupe de copains. Il attendait que le vent magnétique lui renvoyât la balle, mais celle-ci continua son chemin, roulant en suivant la pente du terrain. Alors l’enfant, devant ses camarades médusés, courut vers son ballon, dépassant sans peine la frontière de l’ombre et retrouva sa balle quelques dizaines de mètres au-delà des limites interdites : elle s’était immobilisée sur le bord caillouteux de la rivière Melna. L’enfant joua un moment les pieds dans l’eau, invitant ses copains à faire de même. Tous se précipitèrent sur la plage de galets en poussant de grands cris.
Ensuite le garçon ramassa son ballon et tout le groupe franchit à nouveau la limite sans difficulté. Le garçon de retour chez lui ne dit rien à ses parents, craignant d’être grondé, mais un de ses camarades révéla ce qui s’était produit. Le bruit se répandit vite et dans un grand élan d’enthousiasme mêlé de défiance, les habitants de K se hâtèrent aux bords de la ville pour éprouver eux-mêmes la réalité de cette liberté soudaine. Ravis, ils jouaient à entrer et sortir de l’ombre, riant comme des petits enfants. Les automobilistes faisaient de même, klaxonnant comme des fous.
Depuis combien de temps la frontière interdite avait-elle cessé d’exister ? Quelques jours, des mois ? Impossible de le savoir. En effet, depuis les premiers temps, personne n’avait plus jamais osé enfreindre une loi que l’usage, l’intérêt ou la raison avaient établie comme définitive.
Les citoyens de K goûtèrent brièvement de cette faculté de se déplacer sans contrainte, de retrouver des proches qu’ils n’avaient plus embrassés depuis des mois, mais très vite ils se retirèrent dans les limites de leur disque tutélaire, préférant sa protection réelle à une liberté dangereuse. Le monde extérieur était trop ouvert, trop vaste, trop chargé d’inconnu. Et puis renouer le contact avec des parents ou des amis qui avaient passé tout ce temps à l’extérieur n’était pas aisé. L’incompréhension s’était installée. Les habitants de K, recroquevillés par nécessité dans leur coquille protectrice, étaient différents, intimement modifiés par ce temps qui s’était immobilisé, tandis que le monde autour d’eux avait continué de courir. Ils se sentaient en décalage, ou plutôt dans une forme d’exil intérieur, et ne dédaignaient pas de tirer quelque fierté de cette singularité qu’ils avaient su si bien cultiver.
Car les habitants de la petite ville n’avaient plus de rêves, ils n’en avaient plus besoin, ni de désirs d’absolu. Le disque leur servait d’imagination. Il y avait assez de beauté et de mystère dans cet objet brillant qui tournait lentement, sans jamais se fatiguer, en émettant un léger chuintement, et qui apaisait les inquiétudes par sa présence permanente et rassurante. Et puis ils avaient toujours le loisir de se dire qu’ils étaient des prisonniers volontaires et qu’ils pouvaient sortir de l’ombre du disque à n’importe quel moment, s’ils en éprouvaient l’envie ou la nécessité.
Mais, un matin de septembre, l’échelle reliant « la toupie » à la cathédrale fut enroulée et disparut à l’intérieur de l’objet volant.
Et le lendemain les habitants de la petite ville de K furent réveillés très tôt par les rayons violents d’un soleil ardent. Écarquillant les yeux, ils virent que l’immense disque avait disparu. Il était parti dans la nuit mais personne n’avait rien remarqué. Ni les radars ni les caméras n’avaient enregistré le moindre mouvement dans le ciel de K.
Un employé communal, qui vérifiait si la flèche de la cathédrale n’avait subi aucun dommage pendant la présence du disque au-dessus de la ville, fit une découverte étonnante sur l’étroite terrasse du sommet : un ballon rouge et une feuille de papier où figurait un dessin d’enfant représentant une toupie mécanique. Sur la feuille était posé un petit galet pour que le vent ne l’emportât pas. L’agent municipal emmena aussitôt ses trouvailles à la mairie. Monsieur Thorn, le premier magistrat de la cité, les observa avec soin avant de les envoyer à un laboratoire.
L’analyse montra que le galet, un joli caillou, très brillant, très simple, ne provenait pas d’une galaxie lointaine mais sans le moindre doute de la rivière Melna qui traverse la cité.
Le papier du dessin et les couleurs utilisées avaient été achetés dans une petite boutique de la ville. On ne sut jamais quel enfant avait réalisé le dessin. Et le ballon rouge ressemblait à s’y méprendre à celui qu’un garçonnet avait un jour fait rouler au-delà des limites de l’ombre.
Quelque temps plus tard, alors que la vie de la cité avait repris un cours banal, une normalité à laquelle les citoyens s’étaient peu à peu résignés, la municipalité décida de faire ériger devant l’hôtel de ville une statue représentant le disque volant : sur le piédestal on placerait une sorte de châsse à la vitrine transparente, contenant les trois objets découverts. Les autorités religieuses, arguant que le disque était un objet céleste et que le ciel était de leur ressort, firent un procès pour obtenir que l’ouvrage fût implanté sur le parvis de la cathédrale, mais les juges les déboutèrent, décidant qu’il s’agissait d’un monument absolument laïc et communal et que rien ne permettait de déterminer le caractère divin de l’objet volant. Ils firent remarquer que les astronomes pouvaient aussi bien revendiquer le droit de faire placer la fameuse statue devant le télescope du mont Stern, ce qui fit naître une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux.
Le jour de l’inauguration, boudée par le clergé, les beaux discours se succédèrent : maire, député, conseillères et conseillers départementaux, régionaux, même un obscur ministre délégué aux affaires interstellaires. Tous célébraient la maturité et le sérieux des habitants de la ville au cours de cette période de survol du disque, ainsi que l’action remarquable de la municipalité dans la gestion de cette crise inédite.
On avait invité pour l’occasion, afin de leur remettre la médaille du mérite, les citoyennes et citoyens qui avaient eu, à leurs dires, le privilège de monter dans l’objet volant, ainsi que la petite fille qui avait baptisé le disque « toupie », l’enfant au ballon rouge et même la star du cinéma.
Mais tous avaient disparu, envolés, eux aussi, comme le disque qui avait accompagné pendant si longtemps la vie des habitants de la petite ville de K.
© Patricius
mai 2020