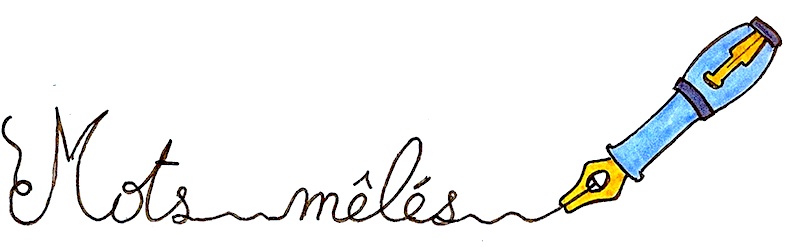(Le texte a été écrit au début de la semaine dernière, quand soufflait une bise forte !)
La vie est là, simple et tranquille.
De l’autre côté de la vitre.
Le soleil pénètre à flots dans la pièce.
Il s’est levé au-dessus du Noirmont, il est en train de passer sur la Dôle, bientôt il doublera les Tuffes, effleurera le Mont Fier et finira sa course toujours exactement calibrée du côté des Arcets. Un peu de neige orne encore la combe du Mont Fier. Michèle et Guy, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là-bas, à l’ombre des Pellas.
Le soleil, qu’est-ce qu’il fait le soleil ?
Il fait son métier de soleil. Toujours le même parcours. Un peu plus bref en hiver, un peu plus long en été.
Mais il s’en moque, le soleil. Infatigable. Réglé comme une horloge... suisse.
La grand-route en face de moi est presque vide. Normalement, à cette heure-là, c’est une file continue de voitures. Les frontaliers vont travailler là-bas, de l’autre côté. Ils fabriquent habituellement des montres. Des montres de luxe. Les usines sont arrêtées. Le luxe, peut-être... Le temps, lui ne s’est pas arrêté.
Faire des montres ? Fabriquer des engins, merveilles du génie humain, pour domestiquer le temps, le mettre dans une boîte ronde, le maîtriser en le réduisant à deux petites aiguilles qui jouent à se poursuivre, en vain, tenter de le dompter comme un animal indocile.
Qu’est-ce qu’il en a à faire, le temps, d’être plié, découpé, déchiqueté, trituré ? Humilié !
On a voulu en faire quelque chose de dur, d’inflexible. On l’a transformé en un serviteur zélé de tous les puissants. De toutes les angoisses. Plus vite, plus vite... Il se venge bien en ces temps de confinement où nos heures s’allongent, où les jours se ressemblent, où il reprend possession du monde... Moi, j’aime les montres molles de Salvador Dalì. J’aime le temps que j’étale sur les tartines de mon petit déjeuner.
Le temps.
Le temps, il se moque de tout ça, de cette agitation, de ce fatras. Il fait son métier de temps.
Le temps, il est comme le soleil, il est le soleil.
Il est le vent. Il est les nuages, il est la pluie.
Hier j’ai reçu un message de la FNAC. C’était mon non-anniversaire.
J’ai trouvé l’expression géniale. Ils doivent savoir que je hais les anniversaires. Je n’arrive pas à me réjouir du fait que la terre ait fait un tour de soleil. Que mon temps se réduise de jour en jour. Je le sais, inutile de me le répéter ! Il me semble d’ailleurs qu’il y a quelques millions d’années que ça se passe comme ça, que la terre tourne, tourne, imperturbable, pas de quoi en faire tout un fromage ou même un gâteau.
Chaque année, désormais, je fêterai mon non-anniversaire. Pas toujours à la même date, bien sûr !
Et puis, pour plus tard, j’imagine que je pourrai fêter ma non-maladie, mon non-confinement, ma non-mort...
Je regarde par la fenêtre le pauvre printemps montagnard. Les anciens, qui n’étaient pas des idiots, l’appelaient le « prim » temps, le premier temps. L’année commençait, le temps se faisait plus doux pour les hommes à l’existence si précaire. On respirait, on tuait l’hiver. Et puis la bande au professeur Nimbus et son cortège de religieux est passée par là. Il fallait plier l’année aux ordres divins. C’était trop beau, laisser la nature nous dicter ses lois !
Quelques crocus essaient, tremblotants, de montrer qu’ils sont là, malgré la bise qui les traverse. Pauvres petites fleurs sans défense, elles essaient de mettre un peu de couleur sur une terre jaunâtre brûlée par l’hiver. Elles ne manquent pas de courage et d’abnégation. Mais elles savent qu’elles finiront par gagner par leur opiniâtreté. Les primevères plus astucieuses mais moins braves, savent se mettre à l’abri. J’ai trouvé du bois joli dans le Risoux. Il est très en avance. En avance sur quoi ? La plante, qu’est-ce que ça peut lui faire d’être en avance ou en retard ?
Le bois joli, il fait son métier de plante, ni plus, ni moins.
Les oiseaux me narguent de leur liberté. Hier j’ai vu les premières bergeronnettes. On les appelle aussi Hochequeues, en patois jurassien « remua cova », « remue queue ». Joli, non ? Elles ramassent quelques brindilles çà et là, un peu d’herbe, pour préparer leur nid. Elles n’ont pas de montre ni de calendrier, mais elles savent bien que c’est le moment.
Je regarde par la fenêtre. Le soleil a monté dans le ciel. Il est en face de moi maintenant. La bise agite les grands arbres.
Je suis aux arrêts domiciliaires. Comme une bonne partie de l’humanité. On ne m’a pas mis de bracelet électronique. Pas encore. J’ai droit à une heure de promenade par jour, comme les prisonniers. En italien on dit : « une heure d’air ». Je trouve que c’est l’expression la plus juste. Une heure pour respirer le monde, aspirer sa substance, une heure pour ne pas oublier comment est la vie dehors. Et puis la porte se referme. Comme sur les prisonniers.
Le microbien dictateur totalitaire, avec son nom de cours de latin, avec son pseudo qui pue le laboratoire clandestin, nous a bien possédés. Plus fort que les méchants de James Bond, il s’est emparé du monde entier, en secret, invisible et sournois. Et il ne nous lâche pas. Il se promène à sa guise, de Chine en Italie, de France en Espagne, en Amérique, en Afrique. Peut-être l’avons-nous bien aidé, avec nos avions, nos bateaux, nos camions, nos autos ? Nos cochons qu’on élève en France, qu’on tue en Pologne, découpe en Moldavie, emballe en Slovaquie avant qu’ils ne soient mangés chez nous ? Avec nos montres de luxe vendues à des riches du monde entier qui font leur fortune sur le dos des plus exploités ? Avec nos tee-shirts à trois euros importés du Bangla Desh ?
Victimes de notre propre liberté, que nous croyions sans contrainte, sans limite, et au fond, sans scrupules, garantie à vie si on est du bon côté de la médaille, il nous remet à notre juste place.
Je regarde par la fenêtre.
La vie est là, simple et tranquille.
Retour à la page des thèmes