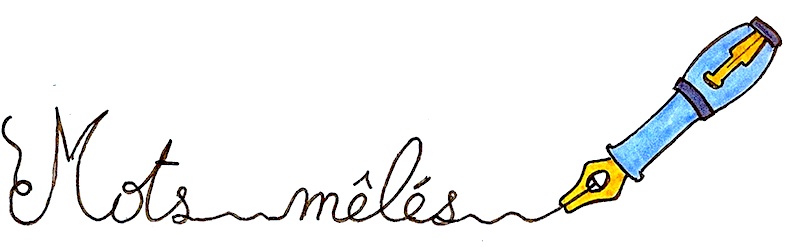Elle était là, au bout de la plaine.
La cité aux murailles d’or.
Maracanda.
Maracanda.
Il était enfin arrivé au bout du chemin.
Dans la brume de chaleur, brillaient, comme autant de soleils, les milles mosquées et les mille églises de la ville.
On disait qu’à Maracanda, des fontaines coulaient le miel et le vin le plus doux, que l’eau la plus pure et la plus fraîche jaillissait dans des vasques de jade.
On disait que dans la ville la plus humble des servantes avait un port de reine, que le plus modeste des manœuvres avait la noblesse des grands seigneurs.
Il observait, fasciné, le reflet du soleil sur les murailles imprenables.
Ses compagnons, épuisés, étaient allongés sur le sol brûlant. Ils n’avaient même pas eu la force de monter le camp.
Il les regarda. Ses fidèles soldats, qui l’avaient suivi dans toutes ses entreprises. Ils avaient vieilli avec lui. Beaucoup étaient morts dans les combats, certains l’avaient quitté pour une femme, un lopin de terre, un commerce, une vie paisible. Il avait toujours été juste avec eux, répartissant de la manière la plus équitable le butin des expéditions. Un élan de tendresse pour ces hommes solides et durs le parcourut.
Toute une vie à la poursuite d’un rêve. D’un rêve qu’il leur avait fait partager et qu’ils avaient vécu avec la même passion.
Plus d’une fois, il aurait pu atteindre Maracanda. Mais toujours il avait évité la ville. Il craignait que son rêve ne s’éteignît dans la réalité de la découverte.
Et puis, tout d’un coup, il s’était senti vieux. Il avait alors décidé qu’il devait aller au-devant de son destin.
Il n’avait eu aucune peine à convaincre ses vieux amis. Il avait suffi qu’il prononçât ce nom : Maracanda. Il leur restait un dernier combat, et ce dernier combat ne les effrayait pas. Rien ne les effrayait s’il était à leur tête.
Le soir tombait, les murailles d’or se teintaient de rose au soleil couchant.
Il regardait toujours la ville où les toits de marbre blanc prenaient des reflets d’argent.
Il y avait si longtemps, il n’était qu’en enfant, il avait entendu un conteur vanter les merveilles de Maracanda, les caravanes venant de tous les coins de la terre, chargées de richesses innombrables, de pierres précieuses, de parfums orientaux, d’onguents et d’or. Les immenses souterrains de la cité où s’entassaient les trésors du monde. Les rues aux pavés couverts de tapis épais pour atténuer le bruit des sabots des chevaux. Les hautes maisons aux toits plats où les astronomes étudiaient la course des étoiles, les palais sans nombre, les épées ciselées, les étoffes précieuses, la soie de Chine, les cotons de la lointaine Perse. Il écoutait l’homme, immobile et sans voix, et, quand il était rentré à la maison, il avait juré à son père qu’un jour cette ville lui appartiendrait. Son père l’avait moqué, mais le rêve n’avait cessé d’habiter l’enfant qu’il était, puis l’adolescent. Enfin l’homme.
Il avait rassemblé autour de lui une troupe vaillante et ils étaient partis par le monde, libres, courant dans le vent des déserts, pillant les villes et les villages, ennemis de toutes les lois, de tous les princes.
Leurs têtes étaient mises à prix, mais toujours ils échappaient à leurs poursuivants.
Un matin, il y avait quelques jours, il avait regardé la jeune captive qui était étendue à côté de lui et il avait été épouvanté.
Il l’avait regardée encore et encore, sa jeunesse, la beauté de son corps à peine adulte, ses longs cheveux qui coulaient en vague brune sur son dos nu, sa taille fine, sa respiration calme, ses lèvres tendres et douces. Et il avait été effrayé. Il voyait en elle un fantôme, un monstre noir au sourire édenté. La jeune femme était l’image du temps, l’image du passé qui le regardait, l’image de l’existence qu’il avait toujours refusée.
L’image de la vie.
Il avait couru devant le temps, et, tout à coup, celui-ci était là, debout, à la porte de sa tente.
Il s’était levé brusquement. La jeune femme avait poussé un grognement puis s’était retournée.
Il avait rassemblé ses soldats, et ils étaient partis, dans un nuage de poussière, laissant leurs bagages, abandonnant leurs serviteurs, leurs esclaves et leurs concubines.
Ils avaient chevauché sans trêve et ils étaient arrivés au bout de la route.
Encore quelques heures de marche et ils seraient au pied des murailles.
Il n’avait pas peur. Et ses hommes n’auraient pas à combattre. La ville n’était pas défendue par des gardes bien armés, des pièges ou des ponts levis. Il avait menti à ses compagnons, ils n’auraient pas à lutter, à risquer leur vie. On ne combat pas un rêve. On ne combat pas contre ses propres songes. On ne se bat pas contre un mirage. Lui seul le savait. Comme il savait que l’heure de rendre des comptes était arrivée.
Il n’aurait plus à combattre que contre lui-même.
La magie de la nuit tombait sur la cité immense.
Des bruits atténués parvenaient jusqu’à lui. Des aboiements, des cris d’oiseaux nocturnes. Une fête, peut-être un mariage, de la musique, des cris aigus de femmes, des vagissements de nourrissons, des chants d’amour.
Se contenter de l’observer de loin. Immobile. Seul.
Laisser les impressions, les sensations, les sentiments, les bruits, les odeurs légères du désert, le souffle ténu des parfums de Maracanda, pénétrer en lui. Comme il ne l’avait jamais fait au cours de son existence mouvementée.
Il regarda une dernière fois la cité, endormie à présent. Noire, parce que la nuit est noire.
Il se leva, se dirigea discrètement vers son cheval, monta, et s’éloigna en silence, dans la direction opposée à Maracanda, puis, quand il fut suffisamment loin du campement, il prit le grand galop.
Il allait la retrouver, enfin, la vieille ennemie, et, cette fois, l’affronter en face.
© Patricius